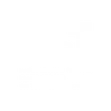Point veille semaine du 9 juin 2025
ILERI - Campus de Lyon Leclair
13/06/2025

Israël, Gaza, Liban : une stratégie d’escalade multidimensionnelle au printemps 2025
Depuis les attaques du 7 octobre 2023, la politique sécuritaire et militaire d’Israël a connu une inflexion marquée vers une stratégie d’expansion territoriale, de contrôle autoritaire et d’affrontement régional. Le printemps 2025 confirme cette évolution à travers trois dynamiques convergentes : l’intensification du conflit à Gaza, la centralisation de l’aide humanitaire autour d’un acteur controversé, et l’ouverture d’un front diplomatique et militaire au Liban. Ces trois axes révèlent une vision géopolitique israélienne orientée non plus vers la gestion de menaces ponctuelles, mais vers une transformation durable de son environnement régional, au risque de provoquer une instabilité prolongée.
À Gaza, une opération militaire devenue entreprise de conquête
L’offensive israélienne dans la bande de Gaza, lancée en octobre 2023, a basculé depuis mai 2025 dans une nouvelle phase avec l’opération Gideon’s Chariots. Présentée comme une offensive destinée à vaincre définitivement le Hamas et à libérer les otages restants, elle révèle en réalité une transformation structurelle des objectifs de guerre israéliens.
Le gouvernement israélien, influencé par ses composantes d’extrême droite, poursuit désormais un objectif idéologique : l’annexion de facto de larges portions du territoire de Gaza, la destruction systématique des infrastructures civiles et militaires, et la mise en place d’un contrôle israélien prolongé. Cette destruction systématique vient du fait que les combattants du Hamas prennent des lieux publics comme les hôpitaux ou les écoles. Cette stratégie, bien au-delà de la simple neutralisation de menaces terroristes, reflète une volonté de reconfiguration territoriale durable, visant à redessiner la carte du Proche-Orient.
L’armée israélienne contrôle déjà près de 40 % de la bande de Gaza et entend porter cette emprise à 70 % d’ici l’été. Des zones entières sont vidées de leur population, les tunnels détruits, les bâtiments rasés. Dans ce cadre, le discours du Premier ministre Benjamin Netanyahu sur une « sécurité israélienne éternelle » à Gaza, conjugué aux propos de ministres comme Bezalel Smotrich appelant à la réinstallation juive dans l’enclave et à l’émigration palestinienne, évoque une stratégie d’occupation déguisée.[1]
L’aide humanitaire comme outil de contrôle : la Fondation humanitaire de Gaza
Parallèlement à cette offensive militaire, Israël a mis en place une stratégie de contrôle de l’aide humanitaire en excluant les agences onusiennes du processus, au profit d’un acteur privé, la Fondation humanitaire de Gaza (GHF). Cette organisation, officiellement soutenue par les États-Unis mais conçue par des acteurs israéliens selon des enquêtes du New York Times et de Ha’Aretz, vise à délégitimer les circuits humanitaires traditionnels et à conditionner l’accès à l’aide à une architecture sécuritaire israélienne.
Les distributions de la GHF ont provoqué plusieurs drames humains, avec des dizaines de morts civils aux abords de ses centres de distribution. Tandis qu’Israël évoque des « tirs de sommation », la GHF nie toute responsabilité. La fondation a temporairement fermé ses centres début juin sans donner de calendrier de réouverture, illustrant le caractère instable et chaotique de cette gestion unilatérale de l’aide, fortement critiquée par l’ONU.
Ce modèle de gestion humanitaire témoigne d’un tournant dans l’approche israélienne : il ne s’agit plus uniquement d’isoler le Hamas, mais de reprendre le contrôle de l’ensemble de la société civile gazaouie, en redéfinissant qui peut vivre, circuler et survivre à Gaza — sur des bases définies par Israël seul.[2]
Le Liban, cible parallèle dans une stratégie régionale de dissuasion
Le 5 juin 2025, Israël a lancé des frappes massives sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion historique du Hezbollah. Ces attaques, les plus violentes depuis la trêve de novembre 2024, ne visaient pas seulement des cibles militaires, mais s’adressaient à plusieurs acteurs : le Hezbollah, le nouveau gouvernement libanais, et indirectement l’Iran.
Le message est clair : Israël ne tolérera pas la reconstitution d’un front chiite à ses frontières nord dans un contexte où Téhéran tente de renforcer son influence régionale au moment même où les négociations nucléaires avec les États-Unis stagnent. En ce sens, les frappes sur Beyrouth apparaissent aussi comme un outil diplomatique indirect au service de Washington, voire un levier de pression dans la diplomatie nucléaire.
Le nouveau président libanais Joseph Aoun, élu avec l’appui occidental, tente de maintenir un fragile équilibre entre la volonté internationale de désarmer le Hezbollah et la nécessité d’éviter une guerre civile. Mais la fermeté d’Israël et les pressions internationales croissantes laissent peu de marge au pouvoir libanais. La population, déjà éprouvée par une guerre précédente, redoute une reprise des hostilités à grande échelle.[3]
Une vision géopolitique fondée sur la force et la durée
Ces trois dynamiques — expansion militaire à Gaza, reconfiguration de l’aide humanitaire, offensive au Liban — traduisent une évolution profonde de la doctrine israélienne. Il ne s’agit plus de sécurité défensive, mais de reconstruction régionale selon des lignes idéologiques, nourrie par la droite radicale israélienne et facilitée par une situation internationale permissive.
L’absence de plan clair pour l’« après-guerre », le refus d’un gouvernement palestinien de substitution à Gaza, l’encouragement à l’émigration, la marginalisation des institutions multilatérales et l’usage de la guerre comme outil de survie politique interne pour Benjamin Netanyahu, révèlent une dérive vers un modèle de guerre perpétuelle, où l’expansion territoriale se fait au prix de crises humanitaires, de pertes civiles massives et d’isolement diplomatique croissant.
Une stratégie à double tranchant
À court terme, cette stratégie peut offrir à Israël des gains tactiques : affaiblissement du Hamas, pression accrue sur l’Iran, dissuasion au Liban. Mais à long terme, elle expose le pays à des coûts exorbitants : guérilla urbaine, fatigue militaire, désaveu international, et polarisation interne. Surtout, elle compromet toute perspective de paix durable, en substituant l’occupation à la diplomatie et la force à la légitimité.
Tant que cette dynamique ne sera pas infléchie par une initiative politique majeure — interne ou extérieure —, le Proche-Orient restera piégé dans un cycle de guerre et de reconfigurations territoriales brutales, au détriment de la sécurité régionale et du droit international.
[1] Israel’s Dangerous Escalation in Gaza, Assaf ORION, Foreign Affairs Magazine, le 3 juin
[2] Qu’est-ce que la Fondation humanitaire de Gaza (GHF), chargée de l’aide dans l’enclave palestinienne ?, Courrier international, le 6 juin 2025
[3] Des raids israéliens sous forme de message à l’Iran et au nouveau pouvoir à Beyrouth, Courrier international, le 6 juin
À Gaza, une opération militaire devenue entreprise de conquête
L’offensive israélienne dans la bande de Gaza, lancée en octobre 2023, a basculé depuis mai 2025 dans une nouvelle phase avec l’opération Gideon’s Chariots. Présentée comme une offensive destinée à vaincre définitivement le Hamas et à libérer les otages restants, elle révèle en réalité une transformation structurelle des objectifs de guerre israéliens.
Le gouvernement israélien, influencé par ses composantes d’extrême droite, poursuit désormais un objectif idéologique : l’annexion de facto de larges portions du territoire de Gaza, la destruction systématique des infrastructures civiles et militaires, et la mise en place d’un contrôle israélien prolongé. Cette destruction systématique vient du fait que les combattants du Hamas prennent des lieux publics comme les hôpitaux ou les écoles. Cette stratégie, bien au-delà de la simple neutralisation de menaces terroristes, reflète une volonté de reconfiguration territoriale durable, visant à redessiner la carte du Proche-Orient.
L’armée israélienne contrôle déjà près de 40 % de la bande de Gaza et entend porter cette emprise à 70 % d’ici l’été. Des zones entières sont vidées de leur population, les tunnels détruits, les bâtiments rasés. Dans ce cadre, le discours du Premier ministre Benjamin Netanyahu sur une « sécurité israélienne éternelle » à Gaza, conjugué aux propos de ministres comme Bezalel Smotrich appelant à la réinstallation juive dans l’enclave et à l’émigration palestinienne, évoque une stratégie d’occupation déguisée.[1]
L’aide humanitaire comme outil de contrôle : la Fondation humanitaire de Gaza
Parallèlement à cette offensive militaire, Israël a mis en place une stratégie de contrôle de l’aide humanitaire en excluant les agences onusiennes du processus, au profit d’un acteur privé, la Fondation humanitaire de Gaza (GHF). Cette organisation, officiellement soutenue par les États-Unis mais conçue par des acteurs israéliens selon des enquêtes du New York Times et de Ha’Aretz, vise à délégitimer les circuits humanitaires traditionnels et à conditionner l’accès à l’aide à une architecture sécuritaire israélienne.
Les distributions de la GHF ont provoqué plusieurs drames humains, avec des dizaines de morts civils aux abords de ses centres de distribution. Tandis qu’Israël évoque des « tirs de sommation », la GHF nie toute responsabilité. La fondation a temporairement fermé ses centres début juin sans donner de calendrier de réouverture, illustrant le caractère instable et chaotique de cette gestion unilatérale de l’aide, fortement critiquée par l’ONU.
Ce modèle de gestion humanitaire témoigne d’un tournant dans l’approche israélienne : il ne s’agit plus uniquement d’isoler le Hamas, mais de reprendre le contrôle de l’ensemble de la société civile gazaouie, en redéfinissant qui peut vivre, circuler et survivre à Gaza — sur des bases définies par Israël seul.[2]
Le Liban, cible parallèle dans une stratégie régionale de dissuasion
Le 5 juin 2025, Israël a lancé des frappes massives sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion historique du Hezbollah. Ces attaques, les plus violentes depuis la trêve de novembre 2024, ne visaient pas seulement des cibles militaires, mais s’adressaient à plusieurs acteurs : le Hezbollah, le nouveau gouvernement libanais, et indirectement l’Iran.
Le message est clair : Israël ne tolérera pas la reconstitution d’un front chiite à ses frontières nord dans un contexte où Téhéran tente de renforcer son influence régionale au moment même où les négociations nucléaires avec les États-Unis stagnent. En ce sens, les frappes sur Beyrouth apparaissent aussi comme un outil diplomatique indirect au service de Washington, voire un levier de pression dans la diplomatie nucléaire.
Le nouveau président libanais Joseph Aoun, élu avec l’appui occidental, tente de maintenir un fragile équilibre entre la volonté internationale de désarmer le Hezbollah et la nécessité d’éviter une guerre civile. Mais la fermeté d’Israël et les pressions internationales croissantes laissent peu de marge au pouvoir libanais. La population, déjà éprouvée par une guerre précédente, redoute une reprise des hostilités à grande échelle.[3]
Une vision géopolitique fondée sur la force et la durée
Ces trois dynamiques — expansion militaire à Gaza, reconfiguration de l’aide humanitaire, offensive au Liban — traduisent une évolution profonde de la doctrine israélienne. Il ne s’agit plus de sécurité défensive, mais de reconstruction régionale selon des lignes idéologiques, nourrie par la droite radicale israélienne et facilitée par une situation internationale permissive.
L’absence de plan clair pour l’« après-guerre », le refus d’un gouvernement palestinien de substitution à Gaza, l’encouragement à l’émigration, la marginalisation des institutions multilatérales et l’usage de la guerre comme outil de survie politique interne pour Benjamin Netanyahu, révèlent une dérive vers un modèle de guerre perpétuelle, où l’expansion territoriale se fait au prix de crises humanitaires, de pertes civiles massives et d’isolement diplomatique croissant.
Une stratégie à double tranchant
À court terme, cette stratégie peut offrir à Israël des gains tactiques : affaiblissement du Hamas, pression accrue sur l’Iran, dissuasion au Liban. Mais à long terme, elle expose le pays à des coûts exorbitants : guérilla urbaine, fatigue militaire, désaveu international, et polarisation interne. Surtout, elle compromet toute perspective de paix durable, en substituant l’occupation à la diplomatie et la force à la légitimité.
Tant que cette dynamique ne sera pas infléchie par une initiative politique majeure — interne ou extérieure —, le Proche-Orient restera piégé dans un cycle de guerre et de reconfigurations territoriales brutales, au détriment de la sécurité régionale et du droit international.
[1] Israel’s Dangerous Escalation in Gaza, Assaf ORION, Foreign Affairs Magazine, le 3 juin
[2] Qu’est-ce que la Fondation humanitaire de Gaza (GHF), chargée de l’aide dans l’enclave palestinienne ?, Courrier international, le 6 juin 2025
[3] Des raids israéliens sous forme de message à l’Iran et au nouveau pouvoir à Beyrouth, Courrier international, le 6 juin
Article rédigé par Jay Thénot-Wrobel
Lee Jae-myung, nouveau président sud-coréen : une stratégie de rééquilibrage dans un monde fragmenté
L’élection de Lee Jae-myung à la tête de la Corée du Sud en juin 2025 ne marque pas seulement une transition institutionnelle après la chute spectaculaire de Yoon Suk-yeol : elle amorce une reconfiguration profonde de la politique sud-coréenne, aussi bien sur le plan intérieur que dans ses rapports avec les grandes puissances. Dans un contexte de rivalités croissantes entre les États-Unis, la Chine et la Russie, Lee propose une stratégie dite d’équilibre pragmatique, fondée sur la restauration de la démocratie, la relance économique et la diversification diplomatique.
🗳️ Une restauration démocratique après une crise politique majeure
La victoire de Lee intervient à la suite d’une période de grave instabilité politique. Le président Yoon, élu en 2022, a été destitué après avoir imposé la loi martiale en décembre 2024. Cette dérive autoritaire a provoqué une forte mobilisation électorale (près de 80 % de participation) et un vote de sanction contre les forces conservatrices. Lee Jae-myung, battu de justesse en 2022, revient en force avec 51,7 % des voix, malgré une campagne marquée par des tentatives de disqualification, des accusations judiciaires et même une tentative d’assassinat en 2024.
Son profil – celui d’un autodidacte issu des classes populaires, devenu avocat, maire puis gouverneur – lui confère une image de résilience politique. Son retour au pouvoir est présenté par la presse comme celui d’un “phénix”, un homme forgé dans l’adversité, aujourd’hui détenteur d’un mandat fort et soutenu par une majorité parlementaire.[1]
🌐 Une diplomatie entre continuité stratégique et volonté d’autonomie
Sur le plan international, Lee entend conserver l’alliance militaire et stratégique avec les États-Unis, qu’il qualifie de pilier fondamental, tout en prenant ses distances avec l’approche idéologique et alignée de son prédécesseur. Là où Yoon s’était fortement rapproché de Washington et de Tokyo, en rupture avec Pékin et Pyongyang, Lee mise sur une diplomatie d’équilibre, plus souple, plus autonome, et surtout, plus adaptable aux réalités géopolitiques.
Dès son discours d’investiture, il appelle à renforcer la coopération avec les États-Unis et le Japon, tout en laissant entendre qu’il souhaite aussi rouvrir les canaux avec la Chine, la Russie et la Corée du Nord. Son positionnement vise à éviter que la Corée du Sud ne soit instrumentalisée dans la rivalité sino-américaine, tout en poursuivant ses intérêts nationaux en matière de sécurité, de commerce et de stabilité régionale.
Cette ligne est incarnée par la nomination de Wi Sung-lac à la tête du Conseil de sécurité nationale, diplomate réputé pour son expertise sur la Russie et le Nord, et favorable à une approche multipolaire et fondée sur les intérêts nationaux plutôt que sur des principes de bloc.[2]
💬 Dialogue nord-coréen et diplomatie économique : les deux leviers du mandat Lee
Le dossier nord-coréen représente l’un des défis majeurs de la présidence Lee. Contrairement à ses prédécesseurs, il ne fait pas de la dénucléarisation un préalable absolu au dialogue. Il reprend l’héritage de Moon Jae-in, en promouvant une coexistence pacifique et progressive, fondée sur des échanges inter-coréens, la stabilité militaire et des projets économiques communs. Il considère qu’une coopération constructive est préférable à une logique d’isolement qui a échoué par le passé.
Son élection coïncide aussi avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, ce qui ouvre une fenêtre de négociation potentielle avec Kim Jong-un. Lee espère jouer un rôle d’intermédiaire entre Washington et Pyongyang, capable de maintenir un dialogue structuré même lorsque Trump se désintéresse des détails.
Parallèlement, Lee place l’économie au centre de sa diplomatie. Il souhaite rapidement négocier un nouvel accord commercial avec les États-Unis, dans un contexte où l’économie sud-coréenne est fortement exposée aux fluctuations du commerce mondial. Semi-conducteurs, automobile, technologies stratégiques : tous ces secteurs sont au cœur des discussions engagées avec Washington.[3] et [4]
🔚 Conclusion
Lee Jae-myung incarne une nouvelle génération de leadership sud-coréen : résilient, réformiste et stratégique. Sa politique étrangère vise à sortir la Corée du Sud d’une logique d’alignement rigide, tout en assurant sa sécurité et son influence dans un monde polarisé. Entre dialogue avec le Nord, diversification des partenariats, et diplomatie économique active, il tente de repositionner Séoul comme un acteur autonome et modérateur dans la région. Le succès de cette approche dépendra de sa capacité à maintenir cet équilibre fragile entre alliance, souveraineté et adaptabilité.
[1] La Corée du Sud a un nouveau président : “le phénix” Lee Jae-myung, Courrier international, le 3 juin.
[2] Avec Lee Jae-myung, la Corée du Sud veut renouer avec une diplomatie d’équilibre entre les puissances, Philippe Mesmer, Le Monde, le 6 juin.
[3] South Korea’s Lee, Trump agree to work towards swift tariff deal, Lee’s office says, Joyce Lee et Hyunjoo Jin, Reuter, le 6 juin
[4] South Korea’s New President Could Transform the Korean Peninsula, Foreign Affairs, le 3 juin.
🗳️ Une restauration démocratique après une crise politique majeure
La victoire de Lee intervient à la suite d’une période de grave instabilité politique. Le président Yoon, élu en 2022, a été destitué après avoir imposé la loi martiale en décembre 2024. Cette dérive autoritaire a provoqué une forte mobilisation électorale (près de 80 % de participation) et un vote de sanction contre les forces conservatrices. Lee Jae-myung, battu de justesse en 2022, revient en force avec 51,7 % des voix, malgré une campagne marquée par des tentatives de disqualification, des accusations judiciaires et même une tentative d’assassinat en 2024.
Son profil – celui d’un autodidacte issu des classes populaires, devenu avocat, maire puis gouverneur – lui confère une image de résilience politique. Son retour au pouvoir est présenté par la presse comme celui d’un “phénix”, un homme forgé dans l’adversité, aujourd’hui détenteur d’un mandat fort et soutenu par une majorité parlementaire.[1]
🌐 Une diplomatie entre continuité stratégique et volonté d’autonomie
Sur le plan international, Lee entend conserver l’alliance militaire et stratégique avec les États-Unis, qu’il qualifie de pilier fondamental, tout en prenant ses distances avec l’approche idéologique et alignée de son prédécesseur. Là où Yoon s’était fortement rapproché de Washington et de Tokyo, en rupture avec Pékin et Pyongyang, Lee mise sur une diplomatie d’équilibre, plus souple, plus autonome, et surtout, plus adaptable aux réalités géopolitiques.
Dès son discours d’investiture, il appelle à renforcer la coopération avec les États-Unis et le Japon, tout en laissant entendre qu’il souhaite aussi rouvrir les canaux avec la Chine, la Russie et la Corée du Nord. Son positionnement vise à éviter que la Corée du Sud ne soit instrumentalisée dans la rivalité sino-américaine, tout en poursuivant ses intérêts nationaux en matière de sécurité, de commerce et de stabilité régionale.
Cette ligne est incarnée par la nomination de Wi Sung-lac à la tête du Conseil de sécurité nationale, diplomate réputé pour son expertise sur la Russie et le Nord, et favorable à une approche multipolaire et fondée sur les intérêts nationaux plutôt que sur des principes de bloc.[2]
💬 Dialogue nord-coréen et diplomatie économique : les deux leviers du mandat Lee
Le dossier nord-coréen représente l’un des défis majeurs de la présidence Lee. Contrairement à ses prédécesseurs, il ne fait pas de la dénucléarisation un préalable absolu au dialogue. Il reprend l’héritage de Moon Jae-in, en promouvant une coexistence pacifique et progressive, fondée sur des échanges inter-coréens, la stabilité militaire et des projets économiques communs. Il considère qu’une coopération constructive est préférable à une logique d’isolement qui a échoué par le passé.
Son élection coïncide aussi avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, ce qui ouvre une fenêtre de négociation potentielle avec Kim Jong-un. Lee espère jouer un rôle d’intermédiaire entre Washington et Pyongyang, capable de maintenir un dialogue structuré même lorsque Trump se désintéresse des détails.
Parallèlement, Lee place l’économie au centre de sa diplomatie. Il souhaite rapidement négocier un nouvel accord commercial avec les États-Unis, dans un contexte où l’économie sud-coréenne est fortement exposée aux fluctuations du commerce mondial. Semi-conducteurs, automobile, technologies stratégiques : tous ces secteurs sont au cœur des discussions engagées avec Washington.[3] et [4]
🔚 Conclusion
Lee Jae-myung incarne une nouvelle génération de leadership sud-coréen : résilient, réformiste et stratégique. Sa politique étrangère vise à sortir la Corée du Sud d’une logique d’alignement rigide, tout en assurant sa sécurité et son influence dans un monde polarisé. Entre dialogue avec le Nord, diversification des partenariats, et diplomatie économique active, il tente de repositionner Séoul comme un acteur autonome et modérateur dans la région. Le succès de cette approche dépendra de sa capacité à maintenir cet équilibre fragile entre alliance, souveraineté et adaptabilité.
[1] La Corée du Sud a un nouveau président : “le phénix” Lee Jae-myung, Courrier international, le 3 juin.
[2] Avec Lee Jae-myung, la Corée du Sud veut renouer avec une diplomatie d’équilibre entre les puissances, Philippe Mesmer, Le Monde, le 6 juin.
[3] South Korea’s Lee, Trump agree to work towards swift tariff deal, Lee’s office says, Joyce Lee et Hyunjoo Jin, Reuter, le 6 juin
[4] South Korea’s New President Could Transform the Korean Peninsula, Foreign Affairs, le 3 juin.
Article rédigé par Jay Thénot-Wrobel
Guerre commerciale : Washington et Pékin s’accordent sur un cadre à Londres
La Chine et les États-Unis ont franchi un pas décisif à Londres en trouvant un accord-cadre pour poursuivre la désescalade de leur guerre commerciale. Malgré l’absence d’annonce formelle, les avancées laissent entrevoir une stabilisation des échanges économiques entre les deux puissances.
Un accord-cadre scellé à huis clos
Réunis du 9 au 11 juin 2025 au Lancaster House de Londres, les représentants américains et chinois ont bouclé une deuxième série de négociations stratégiques dans la plus grande discrétion. Ces pourparlers, engagés à la suite de la trêve tarifaire de Genève, visaient à préciser les engagements réciproques des deux géants économiques. Selon Associated Press (2025)[1], les discussions ont abouti à un accord-cadre couvrant trois axes : les exportations chinoises de terres rares, l’assouplissement des export-controls américains sur les semi-conducteurs, et l’amélioration des conditions d’accès pour les étudiants et chercheurs chinois.
Des avancées sur les ressources critiques et la technologie
L’un des points les plus sensibles concernait les terres rares, indispensables aux industries de haute technologie. La Chine s’est engagée à fluidifier leurs exportations vers les entreprises américaines, en particulier dans les domaines des batteries, éoliennes et équipements de défense[2]. En contrepartie, Washington a accepté de réévaluer certaines restrictions sur les exportations de technologies de pointe, comme les logiciels de conception de puces et les composants aéronautiques.
Un geste sur l’éducation et la mobilité
Pékin a également obtenu un engagement de principe des États-Unis pour assouplir les règles limitant l’accueil des étudiants chinois dans les universités américaines, un enjeu sensible pour les deux pays. Cette ouverture vise à retisser un lien académique mis à mal par les tensions géopolitiques des dernières années[3].
Réactions prudentes des marchés
Malgré l’absence d’annonce officielle, les marchés ont réagi positivement à ces signaux d’apaisement. Les indices boursiers européens et asiatiques ont enregistré de modestes hausses. Toutefois, les analystes restent prudents, soulignant l’incertitude autour de la ratification finale de l’accord par les présidents Xi Jinping et Donald Trump[4].
Une pause, pas une paix durable
Si cet accord-cadre représente une avancée tangible, il ne marque pas la fin du conflit commercial. La trêve tarifaire reste temporaire et les différends structurels notamment sur les subventions industrielles ou la cybersécurité demeurent en suspens. En guise de symbole, les délégations ont conclu leurs discussions autour d’un repas dans une chaîne de fast-food américaine, un clin d’œil ironique dans un contexte toujours fragile[5].
[1] Lawless, J., & Moritsugu, K. (2025, June 10). The US and China say they have agreed on a framework to resolve their trade disputes. Associated Press. https://apnews.com/article/us-china-trade-talks-london-bf991a07e374050ae85c7187f1366ab7
[2] Reuters. (2025, 11 juin). Stocks offer muted cheer to latest US-China trade detente. https://www.reuters.com
[3] The Guardian. (2025, 10 juin). FTSE 100 falls short of record closing high; US-China trade talks 'going well'. https://www.theguardian.com
[4] Reuters. (2025, 11 juin). Stocks offer muted cheer to latest US-China trade detente. https://www.reuters.com
[5] Associated Press. (2025, 11 juin). Global shares climb after China and the US say they have a framework for seeking a trade deal. US-China agree on 'framework' on trade at London talks | AP News
Un accord-cadre scellé à huis clos
Réunis du 9 au 11 juin 2025 au Lancaster House de Londres, les représentants américains et chinois ont bouclé une deuxième série de négociations stratégiques dans la plus grande discrétion. Ces pourparlers, engagés à la suite de la trêve tarifaire de Genève, visaient à préciser les engagements réciproques des deux géants économiques. Selon Associated Press (2025)[1], les discussions ont abouti à un accord-cadre couvrant trois axes : les exportations chinoises de terres rares, l’assouplissement des export-controls américains sur les semi-conducteurs, et l’amélioration des conditions d’accès pour les étudiants et chercheurs chinois.
Des avancées sur les ressources critiques et la technologie
L’un des points les plus sensibles concernait les terres rares, indispensables aux industries de haute technologie. La Chine s’est engagée à fluidifier leurs exportations vers les entreprises américaines, en particulier dans les domaines des batteries, éoliennes et équipements de défense[2]. En contrepartie, Washington a accepté de réévaluer certaines restrictions sur les exportations de technologies de pointe, comme les logiciels de conception de puces et les composants aéronautiques.
Un geste sur l’éducation et la mobilité
Pékin a également obtenu un engagement de principe des États-Unis pour assouplir les règles limitant l’accueil des étudiants chinois dans les universités américaines, un enjeu sensible pour les deux pays. Cette ouverture vise à retisser un lien académique mis à mal par les tensions géopolitiques des dernières années[3].
Réactions prudentes des marchés
Malgré l’absence d’annonce officielle, les marchés ont réagi positivement à ces signaux d’apaisement. Les indices boursiers européens et asiatiques ont enregistré de modestes hausses. Toutefois, les analystes restent prudents, soulignant l’incertitude autour de la ratification finale de l’accord par les présidents Xi Jinping et Donald Trump[4].
Une pause, pas une paix durable
Si cet accord-cadre représente une avancée tangible, il ne marque pas la fin du conflit commercial. La trêve tarifaire reste temporaire et les différends structurels notamment sur les subventions industrielles ou la cybersécurité demeurent en suspens. En guise de symbole, les délégations ont conclu leurs discussions autour d’un repas dans une chaîne de fast-food américaine, un clin d’œil ironique dans un contexte toujours fragile[5].
[1] Lawless, J., & Moritsugu, K. (2025, June 10). The US and China say they have agreed on a framework to resolve their trade disputes. Associated Press. https://apnews.com/article/us-china-trade-talks-london-bf991a07e374050ae85c7187f1366ab7
[2] Reuters. (2025, 11 juin). Stocks offer muted cheer to latest US-China trade detente. https://www.reuters.com
[3] The Guardian. (2025, 10 juin). FTSE 100 falls short of record closing high; US-China trade talks 'going well'. https://www.theguardian.com
[4] Reuters. (2025, 11 juin). Stocks offer muted cheer to latest US-China trade detente. https://www.reuters.com
[5] Associated Press. (2025, 11 juin). Global shares climb after China and the US say they have a framework for seeking a trade deal. US-China agree on 'framework' on trade at London talks | AP News
Article rédigé par Seydou Abass Traoré