Point veille semaine du 7 avril 2025

Une crise née d’un choix stratégique sur le Sahara occidental
Après six mois d’une crise diplomatique aiguë, Paris et Alger amorcent une reprise du dialogue. Si Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune affichent leur volonté d'apaisement, les fractures restent vives, notamment sur le Sahara occidental, la migration et les libertés d’expression.
Escalade diplomatique autour des droits humains et de la migration
La relation franco-algérienne, traversée par une crise d’une rare intensité depuis l’été 2024, amorce une timide désescalade. Le 31 mars 2025, Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune se sont entretenus par téléphone et ont "arrêté le principe d’une rencontre prochaine", selon un communiqué commun rapporté par Le Monde (31/03/2025). Les deux chefs d’État se sont engagés à relancer la coopération sécuritaire et migratoire, jusqu’ici paralysée.
Des efforts de reprise du dialogue fragilisés par le passé
Cette crise diplomatique entre ces deux nations trouve son origine en juillet 2024, lorsque le président français a officiellement soutenu le plan d’autonomie marocain pour le Sahara occidental, au mépris de la neutralité traditionnelle de Paris sur ce dossier sensible. L’Algérie, soutien historique du Front Polisario, a vu dans cette prise de position une "provocation diplomatique", conduisant à un gel des relations bilatérales.
La situation s’est envenimée à l’automne avec l’incarcération de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, condamné à cinq ans de prison pour des propos jugés attentatoires à l’intégrité du territoire. Paris a dénoncé cette décision, tandis qu’Alger pointait un "manque de respect à sa souveraineté". Cette tension s’est doublée d’un bras de fer sur les réadmissions : Alger refusait les laissez-passer consulaires nécessaires à l’expulsion de ses ressortissants en situation irrégulière, malgré les demandes françaises répétées.
La crise a atteint un pic dramatique après l’attaque au couteau survenue à Mulhouse, le 22 février 2025, perpétrée par un Algérien faisant l’objet de plusieurs OQTF (Obligations de Quitter le Territoire Français), restées lettre morte faute de coopération algérienne. Cet événement a ravivé le débat public en France sur la politique migratoire et mis sous pression l’exécutif.
Face à cette spirale, la visite à Alger du ministre français des affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, le 6 avril 2025, a permis d’amorcer un apaisement. Il y a plaidé pour un "dialogue respectueux" et une "reprise durable des canaux de coopération", notamment dans les domaines sécuritaire et judiciaire (Le Monde, 08/04/2025).
Mais cette détente reste fragile. Le passé des relations bilatérales est jalonné de brouilles suivies de réconciliations superficielles. L’éditorial du Monde (08/04/2025) souligne que "rien de durable ne se construit sur un simple lien personnel", pointant l’érosion des mécanismes institutionnels de coopération et la défiance persistante des autorités algériennes.
Si le rapprochement actuel est motivé en partie par l’isolement régional croissant de l’Algérie et par la baisse attendue des revenus pétroliers, il nécessitera plus qu’un échange téléphonique entre chefs d’État pour produire un changement de fond. La reprise du dialogue doit maintenant se traduire en accords concrets, notamment sur les questions migratoires, judiciaires et mémorielles, afin de bâtir une relation réellement apaisée.

Alors que les tensions sino-taïwanaises atteignent un nouveau sommet, Pékin a lancé début avril 2025 de vastes manœuvres militaires autour de Taïwan. Objectif affiché : dissuader toute velléité indépendantiste. Taipei dénonce une intimidation. Washington et Bruxelles s’alarment.
Un « avertissement sévère » : la Chine frappe fort autour de l’île
Les 1er et 2 avril 2025, l’Armée populaire de libération (APL) chinoise a mené des exercices militaires d’envergure autour de Taïwan, baptisés « Tonnerre dans le détroit-2025A ». Objectif de la manœuvre : simuler un blocus maritime et aérien de l’île, accompagnée de frappes ciblées sur des infrastructures critiques. Ces opérations, qualifiées d’« avertissement ferme aux séparatistes » par Pékin, mobilisaient porte-avions (Shandong), avions de chasse, destroyers et troupes terrestres, selon Le Monde (01/04/2025).
Le ministère taïwanais de la Défense a recensé jusqu’à 27 avions et 21 navires chinois évoluant dans son espace périphérique, soit l’une des plus fortes activités militaires depuis octobre 2024 (Le Monde, 02/04/2025). Des images de propagande ont circulé, montrant des simulations d’attaques contre des ports et des installations énergétiques, ainsi que des slogans appelant à « éliminer les traîtres » à la nation chinoise.
Taipei mobilise et riposte sur tous les fronts
Face à cette démonstration de force, Taipei a déployé ses forces armées, mis en alerte ses défenses antimissiles et accusé Pékin d’user de la peur comme outil diplomatique. Le président Lai Ching-te a dénoncé une « intimidation militaire » et qualifié la Chine de « force étrangère hostile ». Le Premier ministre Cho Jung-tai a rappelé que « l’utilisation de la force pour faire pression sur Taïwan est indigne d’une société moderne » (Le Monde, 01/04/2025).
Les États-Unis et l’UE s’en mêlent : risque d’escalade régionale
Du côté de Washington, la réaction est mesurée mais ferme. En visite au Japon, le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth a réaffirmé l’engagement des États-Unis à « maintenir une dissuasion crédible » dans la région, sans confirmer un engagement militaire direct en cas d’attaque. L’Union européenne a, de son côté, appelé à « la retenue », par la voix d’Anitta Hipper, porte-parole de la diplomatie européenne (Le Monde, 02/04/2025).
Un bras de fer stratégique dans le détroit
Pékin considère toujours Taïwan comme une province à réunifier, y compris par la force. Ces exercices, bien que présentés comme défensifs, renforcent une stratégie de pression multiforme : militaire, psychologique et économique. Plusieurs experts estiment que la Chine vise à user Taïwan à l’usure, en rendant son environnement régional toujours plus instable.
Les tensions dans le détroit de Taïwan ne sont plus seulement un dossier local : elles cristallisent désormais les rapports de force entre les grandes puissances mondiales.
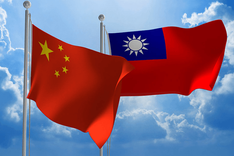
L’accord d’Alger de 2015 remis en cause par Bamako
La destruction d’un drone malien par l’Algérie, suivie de la fermeture de son espace aérien, marque un tournant dans les tensions entre Alger et Bamako. En toile de fond : la rupture par le Mali de l’accord de paix de 2015, et la fragilisation de la coopération régionale au Sahel.
Vers une dégradation durable de la coopération régionale ?
Le 7 avril 2025, Alger a annoncé la fermeture de son espace aérien aux vols en provenance ou à destination du Mali, dénonçant des « violations répétées » de sa souveraineté. Cette décision fait suite à l’interception d’un drone de reconnaissance malien, abattu à deux kilomètres à l’intérieur du territoire algérien, près de Tinzaouatine, localité frontalière sensible (BBC, 08/04/2025).
Bamako a rejeté l’accusation, assurant que l’appareil effectuait une simple mission de surveillance et s’est écrasé par accident. La junte malienne a convoqué l’ambassadeur d’Algérie et annoncé son intention de porter plainte devant des instances internationales. En réaction, les autres membres de l’Alliance des États du Sahel (AES) le Burkina Faso et le Niger ont rappelé leurs ambassadeurs en poste à Alger, dénonçant un « acte prémédité » et « hostile », contraire aux relations historiques entre les peuples (BBC, 08/04/2025).
Cet incident vient aggraver une situation déjà dégradée depuis la rupture, le 25 janvier 2024, par le Mali de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger. Signé en 2015 entre le gouvernement malien et les groupes armés du Nord, cet accord soutenu par l’Algérie visait à stabiliser le pays par la décentralisation, l’intégration des ex-combattants et des programmes de développement spécifiques. Le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement de transition, a justifié cette rupture par un « changement de posture » des groupes signataires et des « actes d’hostilité » d’Alger, médiateur de l’accord (BBC, 26/01/2024).
Huit ans après sa signature, l’accord était largement en panne. Selon le Centre Carter, moins de 30 % de ses dispositions avaient été mises en œuvre en 2022. La Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), principale force signataire, accusait les autorités de transition de bloquer le processus, notamment sur le désarmement et l’intégration des ex-rebelles (BBC, 26/01/2024).
Pour Ahmedou Ould Abdallah, président du Centre pour la Stratégie et la Sécurité dans le Sahel-Sahara, cette détérioration des relations entre Alger et Bamako ne peut que profiter aux « mouvements terroristes et aux trafiquants », dans un contexte où la coopération régionale s’effondre (BBC, 08/04/2025).
Alors que les tensions militaires s’accentuent dans le nord du Mali, avec la reprise annoncée des anciens camps de la MINUSMA par l’armée malienne, la CMA a déclaré être « en temps de guerre » avec la junte. Les risques d’escalade sont réels, selon l’expert Alpha Alhadi Koïna, qui appelle à une reprise urgente du dialogue (BBC, 26/01/2024).

Articles rédigés par Seydou Abass Traoré
